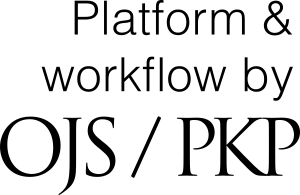The Anthroponyms of Children from Mixed Families: between Identity Issues and the need of insertion
DOI:
https://doi.org/10.48075/odal.v6i1.35017Keywords:
onomastics, anthroponym, mixed families, interviewsAbstract
The "denominative" act is not as trivial as one might think; on the contrary, it is of vital interest because it often conveys issues of identity, religion, and sociocultural importance. This contribution seeks to understand the reasons underlying the anthroponymic choices of children from mixed marriages of families settled in Europe. These families present themselves as a combination of heterogeneous relationships resulting from the encounter of people with different identities and cultures (Deprez et al., 2014). As part of a transdisciplinary approach, the sociolinguistic dimension of this study consists of analysing the representations of Algerian speakers integrated into European societies, with a particular emphasis on their choices regarding anthroponomy. At the same time, from an onomastic perspective, this research seeks to follow the evolution of Algerian anthroponyms in atypical contexts. This sociolinguistic study integrated into the field of onomastics uses a field survey through semi-directive interviews aimed at answering our research questions which revolve around the reasons for attributing anthroponyms in certain mixed families as well as the functions that parents seek to fulfill by naming their child. It turns out that the naming act is complex because it is not only motivated by factors of a religious, cultural and identity nature, this choice also refers to the type of adaptation strategies of each couple (Collet, 2019), their life history, their needs for integration and/or exclusion within the networks and societies in which they find themselves inserted.
References
Collet, B. (2019). Prénommer son enfant dans les couples mixtes : Stratégies d’ajustements interculturels et logiques de genre. Recherches familiales, Vol 1 n°16. P155-167.
Deprez, Gabrielle Varro& Beate Collet. Introduction in Langage et société n° 147 – mars 2014. Paris-Descartes ; CNRS ; Paris-Sorbonne : 7-22.
Dickinson, J. (1998). La prénomination dans quatre villages de la plaine de Caen,1600-1800.Annales de Normandie, 48(1):67-104.https://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_1998_num_48_1_4829.
Khattab, N. (2024). Décryptage anthroponymique et ancrage culturel des prénoms des nouveau-nés dans la vallée d’El Eulma, revue Multilinguales [En ligne], 21 | 2024, mis en ligne le 30 juin 2024, consulté le 10 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/multilinguales/12552;DOI: https://doi.org/ 10.4000/126d1.
Leroy, S. (2006). Les prénoms ont été changés Pseudonymisation médiatique et production de sens des prénoms. Cahiers de sociolinguistique. N°11. Presses universitaires de Rennes. P 27-40. https://shs.cairn.info/revue-cahiers-de-sociolinguistique-2006-1-page-27?lang=fr
Miloudi, Jugurta. (2022). Le choix anthroponymique en Algérie : des orientations du passé à la mondialisation. Revue Maarif،Vol. 17, no. 1 :837-852. https://search.emarefa.net/detail/BIM-1377341
Mathieu Rosay, J. (1985). Dictionnaire étymologique Marabout. Éd Marabout. France.
Slimani, H. (2024). « Sur-dénomination des familles à Mazouna : analyse sociolinguistique des patronymes et leurs usages », Multilinguales [En ligne], 21 | 2024, mis en ligne le 30 juin 2024, consulté le 10 octobre 2024. https://doi.org/10.4000/126d1
Streiff-Fenart, Jocelyne. (1990). Relations interethniques. La nomination de l'enfant dans les familles franco-maghrébines. Sociétés contemporaines. N°4. p. 5-18. DOI : https://doi.org/10.3406/socco.1990.972.
Vion, Robert. (1992). La communication verbale : analyse des interactions. Paris. Hachette. https://agorha.inha.fr/ark:/54721/595fc7eb-b82b-4a77-b518-804c545c9675
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Taguida Abla

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Creative Commons Copyright Notice
Open Access Journals Policy
Authors who publish in this journal agree to the following terms:
1. Authors retain the copyright and grant the journal the right of first publication, with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License that allows the sharing of the work with recognition of authorship and initial publication in this journal.
2. Mandatory authorities to assume commitments, for non-exclusive distribution of the version of the work published in this journal (eg, publish in an institutional repository or as a book chapter), with recognition of authorship and initial publication in this journal.
3. Authors are allowed and encouraged to publish and distribute their work online (eg in institutional repositories or on the personal page) at any point before or during the editorial process, as this can generate productive changes as well as increase impact and citation of the published work (See The Effect of Open Access).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, which allows sharing, copying, distributing, displaying, reproducing, a whole or parts as long as it has no commercial purpose and is cited by authors and a source.